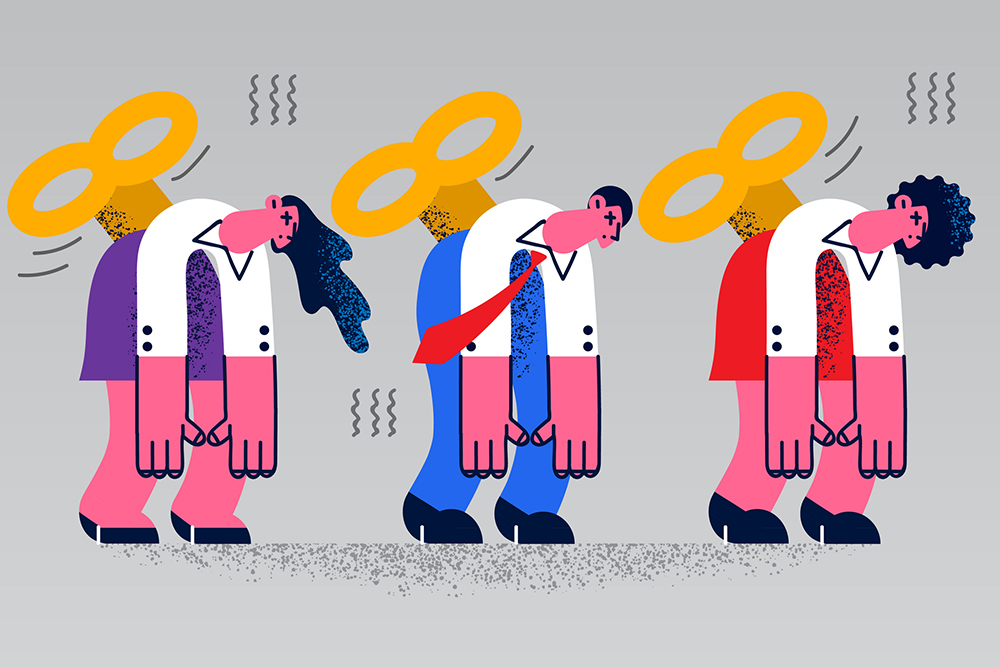Chercheuse depuis 2018 à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), la diplômée Julia Posca (M.A. sociologie, 2011) a publié l’automne dernier chez Écosociété un petit essai de 146 pages qui a fait beaucoup de bruit. Rares sont les essayistes qui bénéficient d’une telle couverture. Paru en Europe en février, Travailler moins ne suffit pas a suscité les éloges de Paul Journet dans La Presse, de Louis Cornellier dans Le Devoir et de Gérald Filion sur Radio-Canada. Même le prestigieux journal Le Monde en a parlé : «Julia Posca appelle de ses vœux une transformation en profondeur du travail, afin que les salariés retrouvent du sens dans leurs activités professionnelles», lit-on sur le site du quotidien français.
Il faut croire que la sociologue a touché une corde sensible. Le travail, souligne-t-elle, occupe une place centrale dans nos vies. Et s’il peut être une grande source d’épanouissement, il engendre aussi beaucoup de détresse. Parcellisation des tâches, perte de sens, peine à se réaliser dans sa carrière, difficulté à concilier emploi et vie personnelle… Selon Statistique Canada, le quart de la population canadienne identifie le travail comme principale source de stress.
Réduire le temps de travail apparaît donc comme une bonne idée, affirme Julia Posca. Son livre énumère d’ailleurs les bienfaits, y compris pour les entreprises, d’une semaine de travail allégée. Mais, soutient l’essayiste, la semaine de quatre jours ne suffira pas à régler le problème de fond lié au travail.
Actualités UQAM – Vous dites que travailler moins ne suffit pas. Pourquoi?
Julia Posca – L’idée de la semaine de quatre jours ou de réduire le nombre d’heures travaillées dans une semaine gagne en popularité. Il est évident que c’est nécessaire ou, en tout cas, que beaucoup de gens ressentent le besoin de travailler moins. De leur côté, les entreprises se rendent compte que ça peut être un moyen d’attirer la main-d’œuvre. Des syndicats et même certains États s’y intéressent. Des expériences ont montré que la santé des travailleurs et travailleuses s’améliore quand on réduit la semaine de travail, alors que la productivité se maintient ou même augmente. Les employés rapportent aussi une meilleure conciliation entre travail et vie de famille. Bref, travailler moins, oui. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne touche pas à la nature des emplois, parce que ça ne remet pas en question les relations de pouvoir au travail et que ce n’est pas suffisant pour rendre le travail plus utile socialement, plus viable écologiquement et plus satisfaisant personnellement.
«Bref, travailler moins, oui. Mais ça ne suffit pas parce que ça ne touche pas à la nature des emplois, parce que ça ne remet pas en question les relations de pouvoir au travail et que ce n’est pas suffisant pour rendre le travail plus utile socialement, plus viable écologiquement et plus satisfaisant personnellement.»
A.U. – Vous montrez que la revendication d’une réduction du temps de travail n’est pas nouvelle. L’histoire du mouvement ouvrier a été ponctuée de luttes visant à obtenir une réduction des heures travaillées. De 1830 à aujourd’hui, ce nombre a diminué de moitié dans les sociétés industrielles. Cependant, vous observez qu’après une chute marquée au cours du dernier siècle, le temps de travail n’a pratiquement pas diminué depuis les années 1980, malgré l’automatisation de nombreuses tâches et l’entrée massive des femmes sur le marché du travail. Comment expliquer cela?
J.P. – Ça fait presque 100 ans qu’on nous annonce la fin du travail, qu’on nous dit qu’on pourra se passer de travailler grâce aux robots. En réalité, on observe, depuis les 40 dernières années, une stabilisation du nombre d’heures travaillées. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais, entre autres, parce que le travail, dans les sociétés capitalistes, est lié à consommation. Avec le salariat, vient la nécessité de consommer beaucoup de choses que l’on produisait autrefois soi-même. Depuis les années 1970, même si les femmes travaillent autant que les hommes, le rythme de consommation s’est accéléré. Les maisons coûtent plus cher, les objets durent moins longtemps et il faut constamment les renouveler. Or, le travail est le moyen de subvenir à ces besoins et, pour les personnes à revenu plus élevé, de maintenir un certain niveau de vie. Le salariat est nécessaire à la reproduction de l’économie. On a besoin de gens qui travaillent, qui consomment, qui s’endettent, et donc qui travaillent pour rembourser leurs dettes.
Il y a aussi le fait que l’économie capitaliste a tendance à créer des emplois pour générer de la valeur et engranger des profits, et non pour répondre à des besoins essentiels. Cela explique qu’on continue à employer massivement des personnes dans toutes sortes de secteurs, alors que l’on avait prédit une diminution marquée du travail nécessaire pour répondre à nos besoins.
A.U. – C’est la raison pour laquelle vous insistez beaucoup sur le lien entre travail salarié et consommation…
J.P. – Oui, et c’est d’autant plus important quand on pense à la réduction du temps de travail. C’est cette réduction à l’œuvre depuis les débuts de l’industrialisation qui a permis le développement du capitalisme. Évidemment, il faut un salaire pour consommer, mais il faut aussi des temps libres. [N.D.L.R. : Au début du 20e siècle, quand le constructeur automobile Henry Ford accorde la semaine de 40 heures (et de meilleurs salaires) à ses employés, il calcule que cela augmentera leur bien-être et leur productivité, tout en leur donnant plus de temps libres pour consommer les produits qu’ils fabriquent.] Des temps libres qui deviennent de plus en plus formatés par les exigences de la consommation de masse: on prend des vacances dans des lieux organisés pour cela, on achète des équipements – des motomarines, des barbecues sophistiqués, des gadgets électroniques et autres babioles clinquantes – pour pratiquer des loisirs de plus en plus marchandisés. Les temps libres sont devenus utiles à la croissance de l’économie.
Donc, si on veut réduire le temps de travail pour consommer encore plus, on n’est pas plus avancé. La consommation est souvent une forme de compensation pour un manque d’autonomie au travail, pour un manque de reconnaissance, pour la perte de sens que vivent nombre de travailleurs et de travailleuses. Or, ces enjeux fondamentaux ne trouvent pas de réponse dans le fait de seulement travailler moins.
«La consommation est souvent une forme de compensation pour un manque d’autonomie au travail, pour un manque de reconnaissance, pour la perte de sens que vivent nombre de travailleurs et de travailleuses. Or, ces enjeux fondamentaux ne trouvent pas de réponse dans le fait de seulement travailler moins.»
Comme je le disais d’entrée de jeu, bien des salariés bénéficieraient du fait de travailler moins sur le plan de la santé et de l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Mais pour répondre au besoin qu’ont les gens d’avoir une emprise sur leur travail, de se sentir utiles et valorisés, on ne peut pas limiter la réflexion à la durée du travail.
A.U. – Selon vous, il est nécessaire de profiter de la discussion sur la réduction de la semaine de travail pour proposer d’autres voies d’organisation du travail. Quelles seraient-elles?
J.P. –J’en arrive à trois principes autour desquels il faudrait organiser l’économie pour rendre le travail plus satisfaisant.
Le premier, c’est la démocratisation de l’économie. Les décisions en matière économique sont très concentrées entre les mains des entreprises et de leurs dirigeants. Pour changer l’économie, il faut redonner du pouvoir à ceux et celles qui travaillent. Ce principe s’incarne déjà dans certaines formes d’entreprises, comme les coopératives, et plus généralement dans le modèle de l’économie sociale. On doit mettre sur pied des organisations où la gestion est plus horizontale pour que l’objet du travail soit décidé par ceux et celles qui sont concernés au premier chef. Mais on doit aussi créer des lieux de pouvoir plus démocratiques dans la société pour décider quel genre d’entreprises on veut pour répondre aux différents besoins.
Le deuxième principe, c’est le contexte dans lequel on produit, selon quelles normes environnementales ou sociales et en utilisant quelles ressources. Dans le contexte actuel, on met très peu de limites au développement économique. Or, il faut, au contraire, se questionner collectivement sur ces limites parce que la planète l’exige, parce que notre existence en dépend.
Le troisième, c’est notre rapport à la consommation qu’il faut revoir. Si on produisait des objets plus durables, on viendrait déjà briser le cycle de la surconsommation. Plutôt que d’être toujours dans un rapport de possession des objets, on pourrait aller vers un rapport d’usage en généralisant le principe de la bibliothèque pour l’étendre à d’autres catégories de biens. On emprunte des livres, mais on pourrait emprunter tellement d’autres objets qu’on utilise une fois par mois ou par année. On pourrait citer plusieurs autres exemples d’usage collectif, comme l’autopartage, qui permettraient de réduire la surconsommation.
Ce vaste programme suppose une réallocation de nos ressources et de notre temps, qui pourrait éventuellement permettre de travailler moins. Mais peut-être pas non plus. Surtout, on travaillerait différemment, d’une façon plus respectueuse de l’environnement et des êtres humains, et possiblement, d’une façon plus satisfaisante. Le travail resterait central parce que c’est une activité fondamentale pour répondre à nos besoins. La différence, c’est que l’objectif du travail ne serait pas de faire croître les profits pour les actionnaires, mais de répondre à des besoins essentiels.
A.U. – D’un côté, le travail aurait plus de sens si les travailleurs et travailleuses avaient plus de contrôle sur ce qu’ils produisent, s’ils avaient le sentiment de produire des choses essentielles à leur bien-être, à celui des autres êtres humains et à l’équilibre de la planète. Et probablement qu’ils n’éprouveraient pas autant le besoin de consommer pour compenser leur insatisfaction. D’un autre côté, en se libérant de la contrainte de produire toujours plus de choses non essentielles qui épuisent les ressources naturelles, on libérerait du temps pour des choses essentielles comme prendre soin de soi, acquérir de nouvelles compétences, prodiguer des soins à des proches, faire pousser un jardin, réparer des objets ou cuisiner…
J.P. – Oui, mais si seules les entreprises qui le souhaitent offrent une semaine de travail réduite ou si le programme de réduction de temps de travail reste volontaire, bien des gens n’y auront pas accès. Il faut que ce soit un choix de société. Avec des semaines plus courtes sans diminution du salaire, on va libérer du temps pour l’espace domestique, pour le travail invisible qui est nécessaire à notre existence, pour toutes ces activités que le marché ne rémunère pas, mais qui contribuent à la qualité de vie, pour ne pas dire à la reproduction de la vie elle-même. Il n’y a pas de vie économique sans l’éducation, sans le soin qu’on apporte aux enfants, aux malades. Ce travail qui est peu valorisé dans nos sociétés doit être mieux partagé, que ce soit dans le cadre de nos relations intimes ou dans la société en général, non seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les groupes, afin qu’il n’incombe pas aux personnes les moins favorisées ou nouvelles arrivantes d’en assumer une part disproportionnée.
A.U. – Vous décrivez une économie post-capitaliste où l’on ne produirait que des biens qui répondent à de vrais besoins, qui ne serait pas basée sur la concurrence ou le profit. N’est-ce pas une utopie?
J.P. – Il y a une dimension idéaliste dans ma proposition, mais elle s’inspire d’expériences qui existent déjà dans notre système. Les coopératives, c’est un modèle qui est déjà intégré à l’économie capitaliste. Le principe de bibliothèque, ça existe déjà. Les normes de production, il y en a déjà. Dans différents secteurs, on a mis en place des normes environnementales qui font, par exemple, que l’air des villes est plus respirable qu’au début du 20e siècle. Mais oui, il y a un travail politique à faire pour transformer le travail. Il faut construire un rapport de force pour faire valoir le bien commun.
«Les sociétés peuvent se donner des règles, et elles le font. Mais oui, il y a un travail politique à faire pour transformer le travail. Il faut construire un rapport de force pour faire valoir le bien commun.»
Le travail, c’est un enjeu collectif et donc un enjeu politique. Chacun essaie d’améliorer son sort individuellement et c’est normal. Mais, en revenant sur l’histoire, j’essaie de montrer que le sort des travailleurs et travailleuses s’est vraiment amélioré quand il y a eu des mouvements collectifs pour faire bouger les États et les entreprises. C’est encore par cette voie-là que l’on pourra changer les choses.
Aussi, on peut dire que c’est très utopiste de penser, comme le veut une certaine idée à la mode, que chacun va pouvoir tirer son épingle du jeu en faisant de bons placements pour prendre sa retraite à 45 ans…
Julia Posca à QUB Radio
Travailler moins ne suffit pas n’est pas le premier ouvrage de Julia Posca, qui a publié, en 2018, Le manifeste des parvenus (Lux éditeur), un essai satirique sur l’utopie d’un Québec peuplé principalement de rentiers et de patrons. En plus d’être chercheuse à l’IRIS, Julia Posca est membre du comité de rédaction de la revue Liberté. Tous les mardis de l’été, elle sera au micro de Pierre Nantel, sur QUB Radio, pour parler des enjeux socioéconomiques de l’heure.